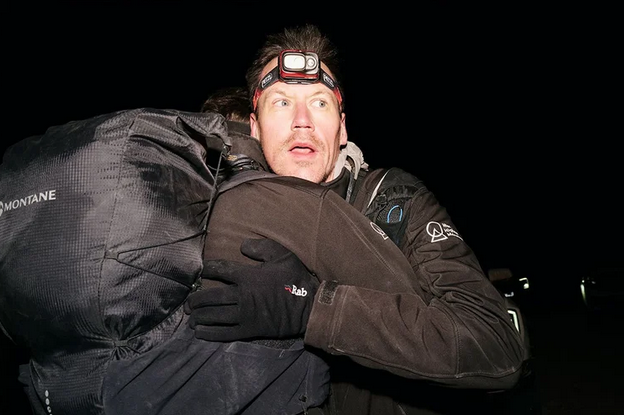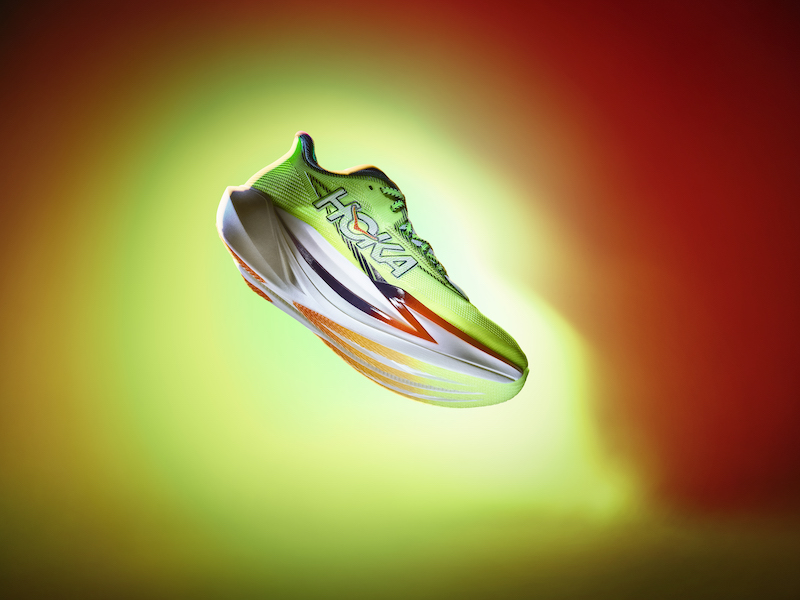Allonger un footing, doubler une sortie, tester une allure plus ambitieuse, c’est toujours tentant. Mais le trop est l’ennemi du bien. Quand la progressivité est négligée, la blessure n’est jamais loin. Des études récentes confirment ce que nombre de coureurs ont appris à leurs dépens : le corps ne suit pas toujours la volonté. Et surtout, il n’encaisse pas n’importe quoi, n’importe quand.
Ce que dit la science
Une vaste étude menée sur plus de 5000 coureurs (Frandsen JSB et al., 2024) pendant 18 mois a révélé un constat sans appel : la blessure survient souvent après une séance unique trop ambitieuse, pas nécessairement après une semaine excessive.
Si une sortie dépasse de plus de 10 % la distance maximale parcourue dans les 30 jours précédents, le risque de blessure augmente nettement. 64% de risque en plus pour une augmentation de 10 à 30% du volume.
Et au-delà de ce ratio, il explose. Ce n’est donc pas le volume hebdomadaire qui blesse le plus, mais la séance trop longue, trop tôt. Courir 15 km au lieu des 12 km prévus de son plan d’entraînement maximise le risque de blessure.
Par ailleurs, une revue complète de la littérature (Damsted et al., 2021) a souligné un point essentiel : la charge seule ne permet pas de prédire les blessures. Il faut aussi tenir compte de la fatigue cumulée, de la qualité de récupération, du passé sportif et de la tolérance individuelle.
Ce qu’il ne faut pas faire

- Faire une sortie longue « bonus » après une semaine chargée.
- Doubler un footing le lendemain d’un travail intensif.
- Tester une allure semi en fin de bloc.
- Ajouter un fartlek parce qu’on a « de bonnes sensations ».
- Mais surtout : copier des séances trouvées sur Internet, vues sur Strava ou issues de plans conçus pour des élites. On croit bien faire, on veut imiter un marathonien de 2h30 ou un coureur de haut niveau… sans avoir construit les fondations nécessaires pour absorber de telles charges.
Ce qui est une séance « standard » pour un athlète entraîné depuis 10 ans peut être un choc brutal pour un coureur qui débute ou même pour un amateur expérimenté sans base solide. La course à pied est un sport ingrat pour les impatients. Elle récompense la constance, pas la précipitation.
Erreurs les plus fréquentes d’entraînement
- Augmenter trop vite la durée ou l’intensité d’une seule séance.
- Supprimer un footing facile pour caser une séance plus exigeante.
- Répéter deux séances de qualité sur deux jours consécutifs.
- Négliger la récupération active, ou l’écarter par manque de temps.
- S’inspirer de coureurs trop éloignés de son profil, sans adaptation.
La bonne stratégie en 8 conseils

- Respecter une structure. Celle qui organise la semaine autour d’un nombre limité de séances de qualité, séparées par des footings lents et régénérants. Celle qui pose des jalons, pas des coups d’accélérateur improvisés.
- Raisonner séance par séance. Chaque sortie importante doit s’inscrire dans une logique de progression. Si le footing long fait 1h30 cette semaine, il ne doit pas en faire 1h50 la suivante. Une augmentation de 5 à 10 % maximum d’une semaine à l’autre permet de renforcer sans surcharger.
- Ne jamais empiler les intensités. Une séance au seuil ou à allure spécifique marathon exige 48 heures de récupération active avant toute autre sollicitation intense. Deux séances dures en deux jours ? Jamais.
- Surveiller ses indicateurs internes. Pas seulement la montre ou les kilomètres. La fréquence cardiaque au repos, la qualité du sommeil, la sensation au réveil, la raideur musculaire. Ils ne mentent pas.
- S’adapter à son niveau réel. La planification doit se faire en fonction du passif, du vécu, du volume toléré. L’entraînement d’un marathonien élite n’a rien à voir avec celui d’un amateur visant 3h30 ou 4h ! En choisissant son objectif, il faut être lucide sur son niveau actuel et sur la charge d’entraînement qui pourra être absorbé durant la préparation sur 12 semaines généralement, en fonction de ses propres contraintes (professionnelles, familiales).
- Accepter le temps long. La course à pied est un sport à progression lente, mais régulière. Les vraies marges de progression se construisent année après année, bloc après bloc, pas en “coup de boost”. Il faut des mois pour construire une base solide, des années pour consolider son seuil, son endurance, sa résistance musculaire. Mais c’est justement cette lenteur qui rend les progrès durables.
- Faire de la récupération une stratégie. Ce n’est pas du repos passif. C’est une partie intégrante de l’entraînement. Elle conditionne la régénération, l’assimilation et, au final, l’adaptation.
- Progresser, c’est pousser la limite, sans jamais la franchir brutalement. Un coureur construit sa progression sur des fondations solides : la régularité, la patience, l’écoute. Il ne s’agit pas de faire toujours plus, mais de faire toujours mieux.
L’envie de bien faire pousse parfois à trop faire. Or, la rigueur prévaut sur l’envie, l’adaptation sur l’imitation, la patience sur la précipitation. C’est dans cette discipline invisible, dans ce respect des règles simples mais fondamentales, que se forge la véritable progression — celle qui dure.